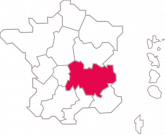ADAPTER L’HABITAT
Le logement est souvent perçu selon sa valeur et celle qu’il produira, plutôt que comme un lieu de vie. C’est pourquoi différents acteurs de l’ESS se saisissent des questions d’habitat, pour proposer différentes solutions, adaptées à différents publics. Les nouvelles formes d’habitat, ce sont plusieurs visions qui coexistent, conjointement ou parallèlement à tous les dispositifs mis en place par les acteurs publics.
Afin d’assurer à chacun de vivre dignement, les logements doivent être conçus et adaptés en fonction des diverses trajectoires de vie : entrée dans la vie professionnelle, études, vieillesse… Certains publics subissent l’invisibilisation, ce phénomène qui conduit, consciemment ou non, à occulter une part de la population. C’est le cas des parents en situation de mono parentalité, des étrangers détenteurs d’un titre de séjour, des jeunes travailleurs précaires, etc... De même que l’allongement moyen des durées d’étude, ou la précarisation des ménages ont conduit à l’apparition de solutions dédiées, l’habitat peut aussi être un vecteur d’adaptation aux transformations profondes de nos sociétés. Pour cela, il s’agit aussi de quantifier pour prendre conscience de leur ampleur : en France, un quart des familles sont des familles monoparentales1.
En fonction des publics
Pour la monoparentalité, la création de communauté géographique de pairs confrontés à des difficultés similaires permet l’émergence de système d’entraide et de soutien entre individu·e·s, parents comme enfants. À l’inverse, l’enjeu vis-à-vis des publics étrangers est de permettre une mixité avec d’autres publics, afin de faciliter la cohésion sociétale. À chaque situation sa solution. Néanmoins dans les deux cas, il s’agit de considérer le logement sous plusieurs facettes. Tout d’abord comme le droit de jouir d’une habitation durable et souhaitable. Aussi, comme des abris mis à disposition d’individu·e·s à des moments critiques, souvent passagers, de leurs trajectoires de vie. Enfin, comme des conditions matérielles d’existence qui, à l’échelle collective, influent sur nos manières de faire société. Et qui, à l’échelle individuelle, peuvent permettre de créer, et conserver le lien social et de le renforcer. Dans tous les cas, il s’agit aussi de percevoir le logement comme l’un des piliers nécessaires et sécurisants pour ensuite s’attaquer à d’autres problématiques complexes et transverses.

Habiter ensemble
En 2021 en France, 3,5% des ménages détiennent 50% des logements en location2. Ici, il n’est pas question des ménages propriétaires d’un appartement : ces 3,5% détiennent tous 5 logements ou plus3. À Lyon, sur la Presqu’ile, c’est environ un logement sur deux qui est détenu par l’un de ces ménages possédant 5 logements ou plus4. Le marché immobilier, spéculatif, caractérisé par la rivalité des biens et la compétition entre un nombre limité de propriétaires, ne semble pas répondre aux besoins d’accès à la propriété ou à la location. Une solution peut être l’habitat coopératif, qui permet d’être tous propriétaires collectivement. En stimulant la participation démocratique dans l’habitat, il peut susciter de l’implication citoyenne au sein du territoire entier. L’habitat coopératif porte une logique ascendante, dite de bottom up. Par ailleurs, la plupart des initiatives d’habitat coopératif cherchent à concrétiser sur cette implication des individu·e·s dans leur habitat afin de la décliner sur le territoire; quartier, ville… Les projets sont porteurs d’une conception de l’habitat au sens large du terme ; allant jusqu’à des valeurs de partage, de solidarité, d’entraide, de résilience etc…
Globalement, il s’agit aussi de lutter contre la spéculation. Les politiques d’accès au logement qui stimulent la demande, soit les acheteur·euse·s, répondent à un problème à un instant T, mais ne répondent pas au problème structurel qu’est la concentration des capitaux immobiliers aux mains de peu d’acteurs, qui les emploient à créer une valeur économique privée. Dans une logique de stimulation de la demande, l’inconfortable situation d’acheteur·euse·s aujourd’hui sera la même dans 20 ans, simplement l’acheteur·euse d’aujourd’hui sera devenu·e vendeur·euse. L’habitat coopératif vise à agir structurellement sur l’offre, c’est-à-dire la structure du marché immobilier, pour sortir de cette logique. La raison majeure est que l’habitat y est perçu comme un bien vital, et qu’il n’y a donc aucune raison que les individu·e·s subissent les fluctuations du marché.
Pour vivre mieux
Réguler le parc locatif existant plutôt que de construire, rénover les bâtiments et penser une construction soutenable, lutter contre l’étalement urbain irréfléchi et ses conséquences sur la biodiversité et les mobilités, autant d’enjeux connexes aux formes d’habitat. La mise en commun de capital et les économies d’échelle qui en résultent, c’est aussi une manière pour les publics ayant moins de moyens d’accéder à un logement sécurisant et sécurisé sur la durée. L’habitat coopératif ou l’adhésion à une foncière solidaire veulent être une troisième voie alternative à la location ou la propriété : une innovation de rupture qui vise à sortir de l’individualisme.
Pour aller plus loin
Lectures :
-
ADAM Matthieu, MESTDAGH Léa. « Invisibiliser pour dominer. L’effacement des classes populaires dans l’urbanisme contemporain ». Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement, nᵒ 43 (21 décembre 2019).
-
LE LABO DE L’ESS. « L’habitat coopératif, une forme de logement solidaire ».
Vidéos :
-
AXANIS, « L’habitat participatif c’est quoi ? »
-
MOUVEMENT COLIBRIS, « Des Habitats qui donnent Vie aux Territoires »
1 INSEE, « Les familles en 2020 - Insee Focus - 249 ». Septembre 2021.
2 INSEE, « France, portrait social, Edition 2021 ».
3 Ibid
4 Ibid