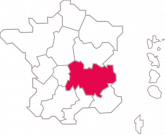Légitimer l'envie d'agir
La vie démocratique est un objet complexe, qui existe à plusieurs échelles, dans différents cadres. Le plus souvent, lorsque nous utilisons le terme de démocratie, c’est pour désigner un régime politique dans lequel le peuple est souverain. Par extension, nous employons souvent l’adjectif démocratique pour qualifier une organisation privée dont la gouvernance tire une légitimité autre que de la simple proportion d’apport de capital. Néanmoins, la vie démocratique existe en dehors des instances politiques.
L’envie d’agir est le premier pas vers l’engagement, quelle qu’en soit sa forme : partis politiques, syndicats, associations, groupements de citoyens… Différents moyens peuvent raviver cette envie d’agir. Le développement de nouvelles instances de participation citoyenne en est un, mais aussi l’utilisation de techniques favorisant la participation, comme les techniques de facilitation. L’idée démocratique repose sur une valeur selon laquelle nous avons toustes le droit d’exprimer notre opinion, mais nous ne nous percevons pas toustes égaux en légitimité. Sans techniques d’animation adaptées, certaines personnes s’autocensureront, d’autres prendront nécessairement plus de place, les orateurs les plus confiants risquent de convaincre en faisant primer la forme sur le fond… L’avis d’un grand nombre peut s’en retrouver étouffé.

Cultiver la démocratie
La démocratie est une culture qui peut être cultivée tout au long de la vie, dans toute la société. Elle se fonde sur la citoyenneté en tant qu’ensemble des pratiques par lesquelles l’individu s’investit dans la communauté politique, mais aussi les processus qui le reconnaissent comme membre du corps social1. Elle peut être inculquée en cherchant à donner du pouvoir de décision aux jeunes, à créer de l’acculturation à ces pratiques et processus. De l’école aux organisations professionnelles, il existe de nombreux secteurs dans lesquels nous pouvons chercher à stimuler l’implication de toustes, afin qu’elle devienne une habitude. Pour autant, afin qu’un public impliqué le reste, il faut qu’il puisse percevoir l’utilité de sa contribution : pas d’implication durable sans preuve tangible qu’il est devenu une réelle partie prenante du processus de décision.
Le pouvoir aux citoyen·ne·s
La finalité serait de ne plus avoir à se questionner sur une stimulation de la vie démocratique. Pour cela, des leviers efficaces peuvent être de favoriser l’empouvoirement des individus, leur montée en compréhension et en pouvoir d’agir. Pour cela, les structures de l’ESS et les collectivités locales cherchent à accompagner des projets ascendants, car cela apparaît comme un moyen de susciter l’adhésion, et donc la pérennité des actions. Il s’agit de responsabiliser et donner les clés, d’accompagner à l’adoption d’une posture active plutôt que passive.
Car la participation citoyenne n’est pas qu’un objectif : c’est une manière de faire société, qui passe par l’expression et la reconnaissance des opinions et intérêts de toustes. Cela implique différentes logiques d’implication. Par exemple, la consultation est une forme passive de participation ; il n’y a pas d’obligation de prise en compte du ou des avis formulés2. À l’inverse, la co-construction est l’implication d’une pluralité d’acteurs, de l’élaboration jusqu’à la mise en œuvre d’un projet ou d’une action3. Ces deux manières de faire contribuent différemment à stimuler la vie démocratique, et elles ne sont que deux exemples d’un riche éventail de conception de la participation.
Pour aller plus loin
Lectures :
-
Labo Cités. « Petit guide lexical de la participation ». Les Cahiers du Développement Social Urbain 62, nᵒ 2 (2015): 46 46.
-
Les travaux d’OSTROM Elinor sur les communs
-
PITSEYS John. « Démocratie et citoyenneté ». Dossiers du CRISP 88, nᵒ 1 (2017): 9 113.
-
Assemblée Nationale. « Rapport numéro 4987, présenté par Pacôme RUPIN et Raphaël SCHELLENBERGER ».
1 PITSEYS John. « Démocratie et citoyenneté ». Dossiers du CRISP 88, nᵒ 1 (2017): 9 113.
2 Labo Cités. « Petit guide lexical de la participation ». Les Cahiers du Développement Social Urbain 62, nᵒ 2 (2015): 46 46.
3 Ibid